The Caryatids, de Bruce Sterling (SF)
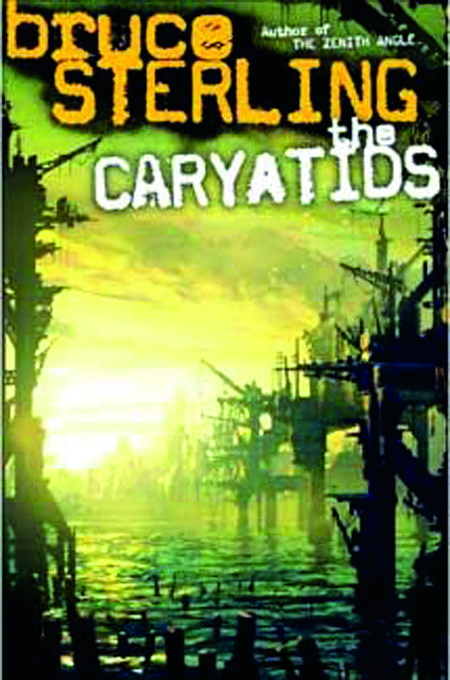
Bruce Sterling
The Caryatids
New York, Del Rey, 2009, 304 p.
On est en 2060 et rien ne va plus depuis un bon moment. Pour mémoire, les Caryatides, ce sont les statues féminines qui soutiennent le portique de l’Érechtéion, sur l’acropole d’Athènes. Et ce sont, dans le roman, les quatre « sœurs » Mihajlovic, des clones surhumaines (ou post-humaines) de la veuve d’un seigneur d’une autre future guerre des Balkans, désormais exilée dans une station spatiale orbitale. Elles se sont refait une vie chacune de son côté après avoir connu la dure existence des réfugiés en mode post-apo explosif. Vera s’est vouée à la reconstruction de son île natale (un désastre écologique) ; Sonja (oui, Red Sonja) est devenue mercenaire bras-de-fer au service de (ce qui reste de) la Chine ; Radmila vit une existence de star mondiale, mariée à un membre influent de l’aristocratie hollywoodienne qui est aussi la classe politique californienne ; Biserka, la quatrième, est morte ou vivante, on ne sait, mais réapparaîtra comme dea ex machina au dernier quart du roman. Elles ont un frère, Georges, devenu un homme ordinaire, ou qui le prétend, marié, avec des enfants. Les quatre clones, fortement traumatisées par leur passé, se haïssent toutes cordialement. Elles et leur frère ont été créés pour « sauver le monde », mais le projet a foiré lamentablement lorsque la bulle techno-protectrice qui les entourait a été détruite, à leur adolescence, au cours d’une des convulsions guerrières qui secouent régulièrement un monde sans cesse en voie d’effondrement/reconstruction sur fond de diverses catastrophes naturelles ou man-made (par exemple, des expériences de géo-ingénierie nucléaire de la Chine dans les Himalayas et bien sûr des pandémies à répétition).
Après l’échec et la disparition des nations, deux principales factions jouent les pompiers de tous les incendies, ni vraiment antagonistes ni vraiment neutres mutuellement non plus : les « Acquis », hyperbranchés entre eux et sur l’environnement, toujours sur la brèche écologique mais avec des technologies expérimentales qu’ils espèrent pouvoir appliquer au monde entier, et la « Dispensation » qu’on peut traduire par « distribution » mais qui s’applique aussi bien à l’abstrait (par ex. la justice) qu’aux biens matériels. Cette dernière est une variété bizarroïde de néolibéralisme corporatiste assez machiavélienne et pour qui la technologie et le profit sont censés régler tous les problèmes. Il faut y ajouter une faction religieuse également dédaignée par les deux autres, et qui n’a pas leur pouvoir de traction sur la réalité mondiale. L’action s’engage lorsque John Montalban, officiel dispensionniste majeur et époux de Radmila, vient rencontrer Véra sur son île dans un but d’abord énigmatique. Une éruption solaire qui frit le satellite où se trouve la mère criminelle des clones, et la mort de l’aïeule et cheffe du clan Montalban, à la vie un peu trop longtemps étendue artificiellement, viennent s’ajouter aux réjouissances pour compliquer un peu plus les choses.
Je ne poursuivrai pas plus avant le résumé. Le mot qui décrit le mieux ce roman en est un qui sera familier aux adeptes du cyberpunk dont Sterling est un des représentants canoniques : gonzo. The Caryatids est une satire féroce (rien que le titre…) et ne s’embarrasse guère de vraisemblance, une charge qui explose dans le plus grand désordre et tous les azimuts. Qu’on ne demande pas des personnages attachants, ni une intrigue solide, ni un arrière-monde cohérent. C’est comme si Sterling, exaspéré/désespéré et pour se défouler, avait pris les tropes courants du post-effondrement cyberpunk, les avait mis dans un chapeau, avait secoué le tout et sorti ensuite les éléments un par un en se mettant au défi de les ajuster les uns aux autres en y ajoutant quelques-uns de son cru. Que ça se tienne, même minimalement, est une sorte de réussite. On se trimballe des Balkans à Hollywood ou en Mongolie, avec des personnages déjantés auxquels on ne croit pas une seconde – ce n’est de toute manière pas du tout le point de l’affaire (par exemple l’amant provisoire de Red Sonja, énième clone d’une espèce de Gengis Khan), les dialogues sont soit des manifestes soit des échanges quasi-surréalistes, et le narrateur se paie la traite avec les descriptions infodumps allègres (mais en général brèves) remplies de pointes acérées.
Et le tout date de 2009.
Il est parfois intéressant de lire un roman de SF assez longtemps après sa parution, surtout lorsque le motif dominant (le post-apo) en semble tellement à la mode. Et de lire ensuite les commentaires de lectrices et lecteurs qui l’évaluent à l’aune de leur ici & maintenant (je suis allée m’encanailler sur Goodreads, pour voir). Il semble que dix ans après, et en tout cas en milieu SF anglophone, le mode ironique ne soit plus de mise quand il s’agit d’apocalypse. Le roman n’a du reste pas été et ne sera pas non plus traduit en français, je gage, malgré les lettres de noblesse de son auteur. Autres temps, autres mœurs. L’urgence (climatique) et l’actualité (politique) exigent désormais un sérieux convaincu et un effort au moins apparent de Trouver des Solutions. On verra ce qu’il en sera de ces romans-là dans dix ans…
Élisabeth VONARBURG
